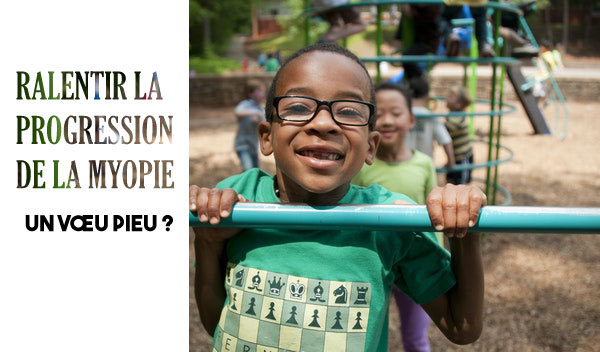
La progression de la myopie ne semble pas avoir de fin. La problématique, souvent associé à un mode vie occidental qui fait la part belle au travail sur écran, est en réalité d’ordre global. Malgré de nombreux efforts, et une recherche qui qui se focalise sur les meilleurs moyens de la freiner, la myopie semble encore gagner du terrain. Alors que se développent toujours plus les objets numériques et que l’accès aux soins se facilite, vouloir freiner la progression de la myopie s’apparente-t-il à un vœu pieu ? À l’instar du changement climatique, ne faudrait-il pas mieux privilégier l’adaptation à la prévention ?
Les chiffres alarmants de la myopie : une véritable « épidémie »
Depuis plus de dix ans, les chiffres prennent une tournure folle. En 2012, un professeur de l’Université de Singapour révélait que 78% des chinois de 15 ans étaient myopes ! Dans les lycées australiens, on parle de 80 à 90% des élèves. Aux États-Unis et en Europe, le taux de myopes a doublé par rapport aux années 70. Comment se fait-il que cette progression soit si fulgurante ? Pour le professeur Gilles Renard, directeur scientifique de la Société française d’ophtalmologie, l’explication est toute trouvée. «Les grands foyers de la myopie se concentrent d’abord au sein des civilisations qui ont développé l’écriture. Elle sollicite beaucoup la vision de près. Et aujourd’hui, de plus en plus, les enfants et les jeunes sont touchés à cause de l’utilisation des écrans.»
Pour Ian Morgan, chercheur de l’université de Canberra, solliciter la majeure partie du temps la vision de près force à l’accommodation. Or, cette dernière fatigue les yeux et favorise la myopie. En effet, regarder des objets de près (livres, écrans…) « force nos yeux à forcer ». Un mode de vie qui privilégie le fait de se trouver à l’extérieur empêche cela. En prime, sous les rayons du soleil, la rétine libère de la dopamine, un messager chimique au rôle crucial dans la transmission des images au cerveau. Par manque de dopamine, l’œil s’agrandit et favorise également la myopie. Cela explique que celle-ci se développe fortement chez les adolescents.
Est-il concrètement possible de ralentir la myopie ?
On peut se poser une question. Alors qu’on s’accommode à vivre avec la myopie grâce aux dispositifs optiques, pourquoi faudrait-il à tout prix ralentir sa progression ? Tout d’abord parce l’accès aux soins optiques n’est pas à proprement parler quelque chose de « facile » suivant où l’on se trouve. Dans certaines parties du globe, pouvoir effectuer un contrôle et une correction s’apparente à un parcours du combattant. Et même dans nos pays occidentaux où l’accès aux soins est facilité, cela peut s’avérer compliqué. Notamment au vu des délais pratiqués en ophtalmologie.
D’autre part, la myopie provoque de nombreuses complications oculaires, comme la cataracte, des risques de décollement de rétine, glaucome, maculopathies…Ralentir la progression relève donc d’un enjeu de santé public. Dans une société où l’on peut difficilement se passer de nos ordinateurs, tablettes, smartphones ou télévisions, l’ampleur de la tâche semble considérable.
Une chose est sûre : la myopie ne peut pas être stoppée. Mais peut-elle est ralentie ? De nombreuses études ont été menées sur le sujet. Des pistes ont été proposées, comme l’adaptation de lentilles rigides, la prescription de verres progressifs ou à double foyer, l’intérêt des lentilles bifocales ou encore l’orthokératologie.

Mais parmi toutes ces pistes, les lentilles rigides se sont avérées une fausse bonne idée car elles ne permettent pas de ralentir l’élongation du globe oculaire chez les plus jeunes. Les verres progressifs eux, ont pour but de pallier à l’insuffisance de l’accommodation des jeunes myopes. Mais dans ce cas précis, si un ralentissement a pu être observé, il est insignifiant et ne s’avère pas être une bonne piste.
L’orthokératologie est une technique de correction médicale de la myopie, qui consiste à faire porter des lentilles rigides la nuit, pour induire une correction temporaire de la myopie, dont la durée espérée couvre la journée suivante. Elle permet un changement de forme de la cornée en l’aplatissant. Cette technique s’avère efficace mais pour les myopies dites faibles. Les lentilles bifocales, elles, permettent de ralentir la progression de la myopie chez les patients de plus de quarante ans.
Mais concernant les plus jeunes, si on a tendance à encourager souvent la lecture, il ne faut pas oublier que l’élément essentiel est, lors de la phase de croissance, de passer un maximum de temps à l’extérieur…plus facile à dire qu’à faire !
S’adapter plutôt que prévenir ?
Alors que ces différentes études n’ont pas offert les solutions espérés, certains industriels ont fait des progrès significatifs en matière de ralentissement de la myopie. Ainsi, les verres Stellest d’Essilor ont, au-delà de très belles promesses, obtenu des résultats très convaincants. Comme rapportés par une étude de la prestigieuse revue JAMA Ophthalmology (Journal of the American Medical Association), après deux ans de port, le ralentissement de la myopie chez les jeunes enfants est significatif. D’après le célèbre verrier, le port, douze heures par jour, du dispositif permet de ralentir la progression de la myopie de 67% par rapport aux autres verres unifocaux.
Pour le docteur Jinhua Bao, directeur du laboratoire de la myopie et de la fonction visuelle, « Ces résultats impressionnants démontrent clairement que l’utilisation de verres HAL (hautement asphériques), au lieu de verres unifocaux pour la correction de la myopie, serait une approche stratégique pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants. Une étude qui montre également que plus la solution de contrôle de la myopie est portée, plus elle est efficace. »
Ces très bons résultats sont la preuve qu’un ralentissement est possible. Finalement, il semble donc que ce soit bien l’adaptation qui soit privilégiée, non la prévention. Pourtant, l’un ne va pas sans l’autre. S’il apparaît compliqué de passer tout son temps dehors avec ses enfants et jusqu’à la fin de leur croissance pour qu’ils ne soient pas soumis aux affres de la myopie, les dispositifs permettront de ralentir une progression indéniable. Mais, pour ne pas verser dans le fatalisme, on peut également remettre en cause des modes de vies qui privilégient l’utilisation, bien souvent superflue, de smartphones par de jeunes enfants, provoquant une défiance du monde extérieur qui a des impacts sociaux et de santé incontestables.
Bien entendu, les écrans ne sont pas uniquement en cause. Le fait, pour un enfant, de passer sept heures par jour en classe à fixer une feuille de papier ou un tableau, n’aide pas. Voilà aussi pourquoi la proportion de myopes augmentera sans cesse. Là encore, une remise en cause peut s’avérer bénéfique. Mais il faut reconnaître que, pour des raisons valables, dans toute société, le changement s’avère souvent bien compliqué.
Sources : Essentiel de l’Optique, https://sante.lefigaro.fr, Docteur Damien Gatinel https://www.gatinel.com/

L’essor d’une mondialisation sans limite, la crise sanitaire, l’inflation galopante poussent les professionnels, salariés comme indépendants, à se réinventer. Que ce soit pour donner un sens à son métier, faire des économies, retrouver le goût du service ou échapper à la routine, on cherche de nouvelles solutions. Elles peuvent être organisationnelles, logistiques, managériales, basées sur des convictions et principes plus importants à nos yeux que le seul salaire. Dans le secteur optique, on n’échappe pas à cette révolution. Depuis quelques mois, des tendances se sont affirmées. Certains ont décidé d’être acteurs de leur propres destins. Alors, ils ont pensé l’optique autrement. Seconde main, opticiens mobiles, fabrication écologique, toutes les idées sont sur la table, et souvent bien menées.
Opticiens mobiles : le service avant tout
Se recentrer sur la relation avec le client. Voilà le crédo des opticiens mobiles. Le magasin d’optique, bien qu’avantageux sur certains points, n’offre plus toujours satisfaction, et certains opticiens ont parfois l’impression que leur métier n’a plus de sens. Répondre au téléphone lorsqu’on est avec un client, réceptionner une livraison à des moments inopportuns, donner parfois l’illusion de courir de partout, avoir une offre toujours plus grande et peu ciblée…Le parcours client semble en sursis dans l’optique d’aujourd’hui. Les offres elles-mêmes ne donnent pas forcément satisfaction : une deuxième paire trop souvent proposée ou choisie par défaut, sans tenir compte des besoins réels du client.

Parce que la mobilité, ce n’est pas forcément le simple fait de se déplacer, et de proposer son service d’opticiens à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ce concept a été expérimenté par certaines grande franchises. Si cela a eu le mérite d’aider une population dans son besoin d’assistance, les nouveaux opticiens mobiles cherchent à maximiser le service.
La franchise ou l’opticien qui propose ses services à domicile ne fera qu’une prolongation de son magasin. La nouvelle offre de mobilité est une démarche bien différente. Elle s’affranchit complètement des activités dispensées en magasin, pour devenir un métier à part entière. Jugez plutôt : l’opticien mobile se déplace avec son matériel technique, 150 montures du même fournisseur et au même prix, faisant ainsi s’effondrer les objections de pouvoir d’achat. Au final, l’expérience s’avère concluante. La démarche répond aux seuls besoins du clients, le rôle de l’opticien est recentralisé : il se déplace pour son conseil de professionnel de santé, et rien d’autre.
Quant aux opticiens eux-mêmes, ils sont maîtres de leur temps et de leurs horaires et gagnent en moyenne mieux leur vie qu’en magasin. Aujourd’hui, trois principales entreprises ont fait le pari de la mobilité. Il s’agit des Opticiens Mobiles, de L’Opticien qui Bouge et des Opticiens à Domicile.
Le marché de l’occasion : le boum du futur ?
Pouvoir d’achat et changement climatique sont parmi les principales préoccupations en France et en Europe. Pour pouvoir consommer sans se ruiner ou créer une dépendance plus grande encore au processus de fabrication, une solution semble toute trouvée ! Avec l’émergence et l’explosion des applications comme Vinted ou Le Bon Coin, le marché de l’occasion pèse lourd. Très lourd.
Près de 7,4 milliards d’euros pour être exact. Impossible de passer outre. Bien entendu, dans le secteur optique, difficile de changer de lunettes sans les personnaliser, puisque elles doivent être adaptées. En prime, difficile d’offrir une garantie sur de l’occasion. Et pourtant, certains opticiens s’y sont mis. C’est le cas de Dingue de Lunettes, de la start-up Seecly et de la Lunetterie du Coin, par exemple, qui proposent des montures moins chères, remises en état et remboursables par les mutuelles !
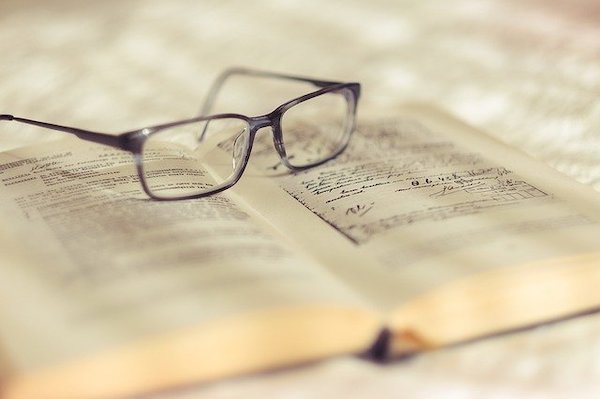
Bien entendu, les montures, pour être remboursables, doivent être achetées chez un opticien agréé. Aussi, il est tout à fait facile de faire varier son offre en proposant une multitude de montures d’occasions. Elles présentent de nombreux avantages : le prix, bien sûr, mais aussi la possibilité de présenter son bagage technique, de proposer des montures très anciennes, dotées d’une véritable histoire, et de mettre en avant une responsabilité environnementale au sein de son entreprise.
Le marché de l’occasion, comme pour les opticiens mobiles, a le vent en poupe. La nouvelle façon de consommer, qui accompagne toujours les crises de la mondialisation, fera certainement la part belle à la seconde main. Et des crises, ce n’est pas ce qui manque en ce moment !
L’Éco-conception : tout redéfinir ?
Fabriquer du neuf peut également s’affranchir des conditions obsolètes de production. C’est le principe de l’éco-conception. Savoir comment et pourquoi utiliser tel ou tel matériau est la responsabilité de tout artisan. Pour cela, il est nécessaire, voire obligatoire, de s’informer, et de financer la recherche et le développement afin de trouver des solutions viables. De nouveaux labels sont d’ailleurs apparus pour tenter de renforcer la responsabilité écologique des acteurs.

©️Acuitis
L’une de ces solutions a beaucoup fait parler ces dernières semaines : la conception d’un nouveau matériau recyclable pour la fabrication de montures. L’acorium est sorti du laboratoire nantais d’Acuitis. Il est fabriqué à base d’acétate bio et de poudre de cuir au tannage végétal. Entièrement recyclable, il offre en plus un look singulier et vintage grâce à un aspect de cuir vieilli.
Cet exemple de réussite démontre parfaitement la capacité de certains acteurs industriels à offrir de nouvelles perspectives de production, alliant prouesse technologique, respect de l’environnement et réponse à la demande commerciale. Bien sûr, on a hâte de pouvoir déterminer les retombées d’une telle trouvaille.
L’éco-conception de produits optiques vient considérablement rebattre les cartes et redéfinir l’avenir de l’optique. Alors que les différents salons internationaux de l’optique mettent de plus en plus l’accent sur la nécessité de faire grandir des convictions liées à la défense de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, il semble que le secteur prenne de plus en plus la bonne direction.
L’optique emprunte des voies qui lui semblaient inaccessibles quelques années en arrière. Cette nouvelle façon de voir le métier, probablement accélérée par les événements qui ont eu lieu depuis quelques années (crises financières, crise sanitaire, crises géopolitiques) montre la formidable agilité du secteur. Bien que l’on s’attende à voir émerger quelques voix s’élevant contre la rédéfinition d’un métier ou un quelconque manque de réalisme, il ne faut pas oublier à la fois que l’échec fait partie de la transformation et qu’un secteur qui ne se transforme pas est un secteur qui ne vit pas.


